Walter Tevis ne fut vraiment pas un écrivain prolifique : trois romans de science-fiction, un recueil de nouvelles, deux romans policiers… et le tour est fait. Mais à la quantité il préférait visiblement la qualité, et chacune de ses œuvres fut exemplaire. Une preuve en est, la renommée de ses polars (L’Arnaqueur et La Couleur de l’argent) ainsi que de son premier roman de science-fiction (L’Homme tombé du ciel), tous les trois adaptés avec succès pour le grand écran.
C’est en 1957 que Walter S. Tevis (1928-1984), professeur de littérature à l’université de l’Ohio, commença à publier de la science-fiction — avec la nouvelle « The Ifth of Oofth », dans Galaxy. Il publia encore deux autres nouvelles dans la même revue (elles furent toutes réunies plus tard au sein du recueil Loin du pays natal), puis plaça son premier roman : The Hustler (1959 ; alors étrangement traduit à la « Série Noire » sous le titre de In ze Pocket). Filmé en 1961 sous le titre L’Arnaqueur, ce roman noir rencontra immédiatement un grand succès. Tevis ne revint à la science-fiction qu’en 1963, avec un autre roman appelé au succès, L’Homme tombé du ciel (The Man Who Fell to Earth).
UN HÉROS FRAGILE
« Dans le quartier commerçant de la petite agglomération, il trouva ce qu’il cherchait, une minuscule boutique appelée La Boîte à Bijoux. Non loin de là, il avisa un banc de bois vert. Il alla s’y asseoir, le corps tout endolori par la longue marche qu’il venait d’accomplir. Quelques minutes plus tard, il vit un être humain. »
Situé dans un futur proche qui est déjà notre passé (1972), L’Homme tombé du ciel nous met tranquillement en contact avec monsieur Newton. Cet homme un peu étrange pénètre de bon matin dans une petite ville, observe avec quelque surprise les habitants autour de lui, puis va vendre une bague chez le bijoutier.
J’ai écrit « un homme » ? Mais monsieur Newton n’est pas un homme, justement. Il en a à peu près l’apparence : grand, cheveux blancs et bouclés, air juvénile, peau diaphane, membres frêles, monsieur Newton vient de la planète Anthéa. Là-bas, la civilisation s’éteint, minée par des guerres trop longues… La Terre est le dernier espoir de survie du peuple d’Anthéa : si leur envoyé pouvait trouver un terrain d’entente avec nos gouvernants, les rescapés d’Anthéa pourraient venir le rejoindre. Le bénéfice serait mutuel : les Anthéens ne sont pas nombreux, et leur savoir pourrait permettre à notre planète de ne pas sombrer dans la même violence que la leur. Ensemble, terriens et anthéens pourraient s’aider, ils pourraient éviter de commettre des erreurs déjà connues.
Monsieur Newton est devenu aussi humain que sa science et son empathie le lui permettait, et il commence les démarches pour se faire reconnaitre. Mais il est seul. Et la Terre lui est subtilement hostile : la pesanteur l’écrase peu à peu… Pas seulement celle de la gravité terrestre, beaucoup plus élevée que celle d’Anthéa, mais également celle de notre bureaucratie. Incompris, se heurtant à l’indifférence, monsieur Newton s’épuise au fur et à mesure que son espoir s’amenuise.
Œuvre délicate et poignante, L’homme tombé du ciel se situe assez loin de la SF traditionnelle. Le seul rapprochement possible serait avec un Simak particulièrement mélancolique… Au sense of wonder, Walter Tevis préféra les touches pastelles d’une littérature intimiste. Au grand spectacle, il préféra le regard intérieur. Son roman n’en fut que plus magistral.
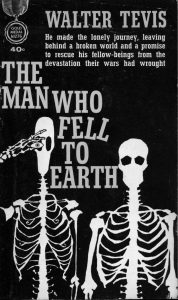 L’Homme tombé du ciel fut publié en France en 1973. Le cinéaste Nicolas Roeg le porta à l’écran en 1976 — dans un film qui ne parvient pas vraiment à capturer toute la magie du roman, mais qui est soutenu par David Bowie dans le rôle principal.
L’Homme tombé du ciel fut publié en France en 1973. Le cinéaste Nicolas Roeg le porta à l’écran en 1976 — dans un film qui ne parvient pas vraiment à capturer toute la magie du roman, mais qui est soutenu par David Bowie dans le rôle principal.
LE TRISTE CHANT DE L’OISEAU MOQUEUR
Walter Tevis se tut ensuite durant près de vingt ans. Son second roman de science-fiction ne parut qu’en 1980 : L’Oiseau d’Amérique (Mockingbird). Le monde s’est lentement éteint. C’était pourtant le meilleur des mondes : plus de misère, plus de guerres, des robots partout pour travailler à la place de l’homme, qui était enfin parvenu à gérer son temps libre… Mais en ce XXVe siècle, les humains ne sont plus très nombreux, il ne reste d’encore habitées qu’une poignée de villes sur le continent américain, dont New York.
Robert Spofforth est un robot de classe 9. Le seul de sa catégorie : les hommes avaient voulu construire les plus sophistiqués des androïdes, en enregistrant chaque influx neural, chaque schéma de reconnaissance d’un cerveau humain, et en le transférant dans le cerveau métallique d’un robot. De cet enregistrement, on avait coupé les parties « inutiles », les souvenirs de l’ingénieur anonyme qui avait servi de modèle, par exemple ; ou le processus de vieillissement, ainsi que les capacités de reproduction. Pourtant, les cent robots de classe 9 furent un échec : ils se suicidèrent les uns après les autres, incapables en particulier de supporter une mémoire totale. On programma donc le dernier, Spofforth, de manière à ce qu’il ne puisse pas mettre fin à ses jours…
Paul Bentley est étudiant dans l’Ohio. Par hasard, il a appris à lire, une technique oubliée en ce triste XXVe siècle. Spofforth l’a fait venir à l’Université de New York — pour le surveiller.
Mary Lou est une fille qui vivait au Zoo de New York, en tout illégalité, profitant de toutes les limitations des robots.
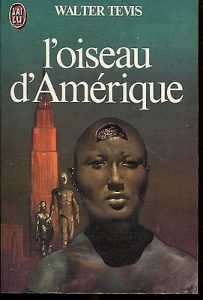 L’Oiseau d’Amérique trace le destin de ces trois individus — individus, oui, le terme est justement important : car dans cette Amérique agonisant lentement a été mis en place une éthique de l’individualisme forcené. La famille est un principe oublié et scandaleux. La Solitude est érigée au rang d’achèvement suprême ! Les suicides sont un spectacle courant dans les rues de New York — la pratique en est interdite, mais il ne semble plus y avoir aucune police, aucune autorité, ni même d’ailleurs aucun personnel d’entretien. Les humains se sont refermés sur eux-mêmes, programmés par leur éducation à ne pas communiquer avec les autres, à ne pas s’intéresser à autrui, à ne pas réfléchir ; du coup, plus personne ne fait rien, et il n’y a pour ainsi dire plus aucunes naissances.
L’Oiseau d’Amérique trace le destin de ces trois individus — individus, oui, le terme est justement important : car dans cette Amérique agonisant lentement a été mis en place une éthique de l’individualisme forcené. La famille est un principe oublié et scandaleux. La Solitude est érigée au rang d’achèvement suprême ! Les suicides sont un spectacle courant dans les rues de New York — la pratique en est interdite, mais il ne semble plus y avoir aucune police, aucune autorité, ni même d’ailleurs aucun personnel d’entretien. Les humains se sont refermés sur eux-mêmes, programmés par leur éducation à ne pas communiquer avec les autres, à ne pas s’intéresser à autrui, à ne pas réfléchir ; du coup, plus personne ne fait rien, et il n’y a pour ainsi dire plus aucunes naissances.
Disparition programmée de la race humaine ? Quel est le rôle de Spofforth dans cette tranquille extinction, lui qui est le dernier à réparer les robots et les appareils, lui qui est le dernier à prendre des décisions, lui qui est le dernier policier — lui qui, pourtant, commence par encourager les recherches de Bentley avant de l’envoyer au bagne, lui qui, asexué, cherche une relation de couple avec Mary-Lou et favorise la naissance de son enfant ?
Walter Tevis parvient à véritablement insuffler la vie à ses trois personnages, à leur faire vivre les peines et les joies de l’existence, à pénétrer leur psychologie, à brosser d’eux un vivant tableau, sans jamais perdre de vue l’enjeu plus vaste qui justifie ce roman : le destin de l’humanité, se jouant… sur quelques détails ! Des outils typiques de la « littérature psychologique », Tevis parvient à faire le moteur d’une œuvre purement science-fictive, envoûtante et enthousiasmante. On y retrouve le plaisir bien particulier d’un style qui eut son heure de gloire dans les années 1970 : cette science-fiction que l’on nommait « spéculative », celle où la chaleur humaine faisait vibrer une littérature visionnaire, celle qu’un Robert Silverberg ou un Thomas Dish maîtrisaient alors à merveille.
Aparté nécessaire : trop souvent, les éditeurs français se croient obligés de trahir les œuvres, en changeant les titres originaux par des platitudes peu enthousiasmantes. C’est encore une fois le cas avec cet Oiseau d’Amérique . Le titre d’origine, « L’oiseau-moqueur », relayait un puissant symbole qui revient en leitmotiv tout au long du roman. Le titre français me semble hélas n’avoir aucun sens.
CONFESSIONS D’UN ENFANT DU XXIe SIÈCLE
S’étant installé à New-York et écrivant à temps complet, Tevis compléta quelques nouvelles qui, avec les anciennes, furent publiées sous le titre global Loin du pays natal (Far from Home, 1981). Ce recueil est un peu trop hétéroclite pour vraiment fonctionner comme un tout, mais il s’en dégage un agréable mélange d’acidité et de mélancolie. Passant d’un humour déjanté à une horreur glaciale, Tevis s’y révèle l’égal d’un Philip José Farmer, sur un thème cher à ce dernier : l’inceste.
Tevis nous donna en 1983 son troisième (et dernier) roman de science-fiction. Le Soleil pas à pas (The Steps of the Sun). Quoique ce n’est pas vraiment d’un roman qu’il s’agit-là, mais bien d’une autobiographie (à la fois fictive et réel : Tevis déclara avoir mis beaucoup d’éléments personnels dans Le soleil pas à pas). On se souviendra que dans 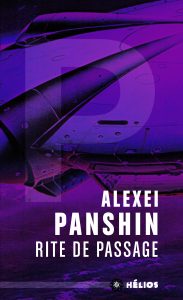 Rite de passage, le très beau roman d’Alexei Panshin récemment réédité chez Hélios, l’auteur avait mêlé bildungsroman (roman d’apprentissage) et space opera. Ici, pour sa part Walter Tevis a mélangé travelogue (journal de voyage) et science-fiction. Le mélange des deux genres pouvait sembler risqué, mais fidèle à sa politique d’hybridation des formes de la littérature générale avec les thématiques de la science-fiction, Tevis le tenta avec brio.
Rite de passage, le très beau roman d’Alexei Panshin récemment réédité chez Hélios, l’auteur avait mêlé bildungsroman (roman d’apprentissage) et space opera. Ici, pour sa part Walter Tevis a mélangé travelogue (journal de voyage) et science-fiction. Le mélange des deux genres pouvait sembler risqué, mais fidèle à sa politique d’hybridation des formes de la littérature générale avec les thématiques de la science-fiction, Tevis le tenta avec brio.
La Terre est fatiguée, appauvrie. Une nouvelle ère glaciaire semble s’approcher et les hommes se sont repliés sur eux-mêmes : les tentatives d’explorations spatiale n’ayant rien donné de bien concluant et les sources d’énergie allant en diminuant, les gouvernements ont décidé de mettre toute la planète sous politique d’austérité. Dans ce contexte tristounet, le milliardaire américain Benjamin Benson viole toutes les lois : il part en vaisseau spatial ! Il découvrira successivement deux planètes habitables — sur la première, à laquelle il donne son nom, pousse une herbe étrange qui chante parfois et des pousses desquelles il tirera un analgésique miracle. Sur la seconde, à laquelle il donne le nom de la jument de son enfance, gise des stocks colossaux d’une matière qui peut être l’avenir de l’humanité : de l’uranium propre.
Hors-la-loi, recherché par toutes les polices des États-Unis, manipulé par les puissances chinoises, ridiculisé par un sénateur corrompu, prostitué par une militaire sadique, passant d’une femme à l’autre, fuyant d’un bout de la Terre à l’autre, Benjamin Benson trouve toujours moyen de retomber sur ses pieds.
Qui dit autobiographie ne dit pas pour autant linéarité : tout le roman est complètement éclaté. L’auteur joue avec un talent consommé des flash-back et des flash-forward, des récits interrompus et des bribes de souvenirs. Pourtant fluide, toujours accrocheuse, cette narration sait être tour à tour caustique et lyrique, désenchantée et exaltée. En cela, le ton du Soleil pas à pas épouse la psychologie de son personnage central : celle d’un vieux bonhomme assez mégalo, pourri par le fric, macho au cœur tendre, trahi par son sexe, souffrant d’instabilité — mais génial.
Souvent hostiles à la psychologie en littérature, comme si la science-fiction n’en était pas une, certains critiques spécialisés accusèrent Le Soleil pas à pas de trop être teinté de sentimentalisme, de trop donner dans le psychodrame. Vous jugerez par vous-même : pour ma part, je tiens ce roman pour une des œuvres les plus originales et réussies des années 1980.
En 1984, Walter Tevis revint à ses premières amours, en livrant une suite à L’Arnaqueur : La Couleur de l’argent, qui — immédiatement adapté au cinéma — remporta un gros succès. Ce devait hélas être sa dernière œuvre : une crise cardiaque l’emporta, à l’âge de 56 ans. Il ne reste au lecteur qu’à spéculer sur les grands romans que cet auteur aurait encore pu nous livrer — et à relire son œuvre, parcimonieuse mais profondément attachante. La petite musique de Walter Tevis n’est pas du genre à s’estomper facilement.
