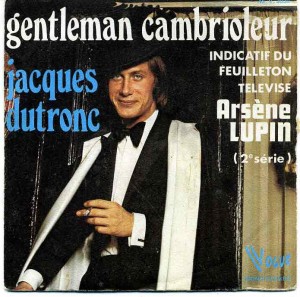Ce que c’est que la mémoire. Je ne sais pourquoi, je croyais que c’était en avril, l’anniversaire de la création de Yellow Submarine. Mais non, c’était bien en mars 1983 que j’ai publié le premier numéro de ce fanzine… Alors, il ne fallait pas perdre de temps, en fait, pour réunir et réaliser le volume spécial 30e anniversaire souhaité par mon camarade Alex Mare. Heureusement, la plupart des auteurs contactés ont répondu immédiatement, avec un enthousiasme qui fait chaud au cœur. Je viens donc de passer une grosse semaine à trimer sur l’OCR, les corrections, la mise en page et tutti quanti. Des travaux d’envergure mais ô combien jubilatoires, quoique par moments un peu troublants : sans céder à la nostalgie, se replonger ainsi dans son propre passé convoque quelques souvenirs et des émotions presque oubliées — je ne suis pas spécialement porté sur le narcissisme et le retour sur soi, mais entre mes travaux d’archivage du blog et cet YS d’anniversaire, je me fais actuellement un curieux « trip » de mémoire.
Enfin, je dois dire que je suis passé d’un sentiment de surprise un peu interloquée et assez prudente (lorsque Alexandre m’a dit qu’il fallait absolument que l’on fête ça — et il avait raison, bien sûr) à un réel enthousiasme, le bonheur de façonner un très beau volume qui approche des 400 pages (et encore, on a été obligés de se limiter). Attention : VPC only, pas de diff librairie (Harmonia Mundi ne pouvant pas gérer les ventes fermes pour le moment, ils ne le feront qu’à partir de cet été hélas). Ça va donc être un « hardcover », sous jaquette couleur (par Lewis Trondheim, trop gentil !), super beau et classe et luxueux et malgré tout pas hypra cher (on a serré le prix à 29 euros port compris).