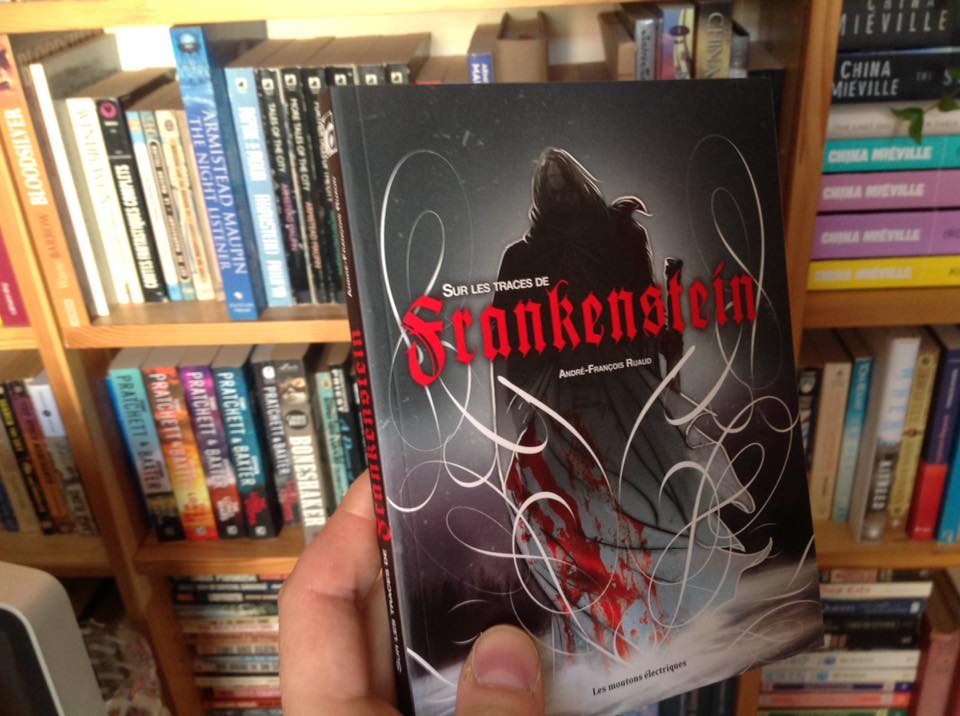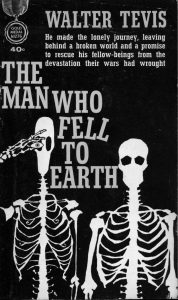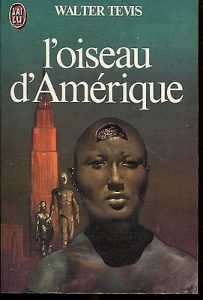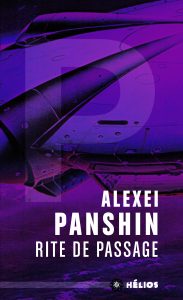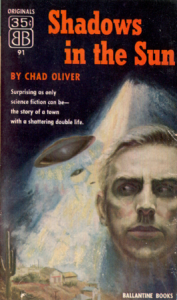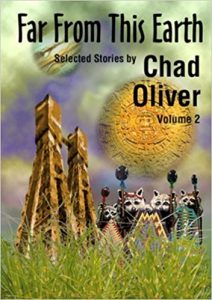Qui a dit qu’il n’y avait pas de vie à Hollywood ? Né en 1954, Alan Michael Brennert aurait pu se satisfaire de sa carrière de scénariste et producteur de télévision, une très belle carrière durant laquelle on a pu voir de multiples fois son nom s’inscrire sur le petit écran — généralement en générique de programmes relevant du fantastique ou de la science-fiction : The New Twilight Zone (La cinquième dimension), Wonder Woman, Buck Rogers… Mais c’est en fait une série hors-genre qui fit le plus de bien pour sa réputation : L.A. Law (La Loi de Los Angeles). En pure produit d’Hollywood, Alan Brennert a également signé de nombreux scénarii pour des comics (principalement des Batman), et il a même fait une petite tentative du côté du support audio (le CD Weird Romance, avec David Spencer et Alan Menken). Seulement voilà : Alan Brennert a toujours eu envie d’étendre son registre au-delà des cadres très contraignants d’Hollywood, et a donc livré de manière parcimonieuse mais assez régulière des œuvres de pure prose, depuis 1973 (date de la publication de sa première nouvelle dans une anthologie, Infinity 5). C’est avec son roman Kindred Spirits, en 1984, qu’Alan Brennert se fit particulièrement remarquer.
Fait-il qu’il soit bon, ce roman, pour ne pas être victime d’une catégorisation abusive : il fut tout d’abord publié sous l’étiquette « YA » (young adults), un label que la France vient juste de découvrir mais qui existe en réalité depuis longtemps. Puis, l’année suivante, il fut réédité avec une maquette de roman sentimental. On lui colla même en couverture un sous-titre ravissant de sottise : « A Christmas love story » (une historie d’amour de Noël). Plus utile était une autre mention, toujours sur la couverture : « pour tous ceux qui ont aimé It’s a Wonderful Life ». Et une citation ajoutait « Une adorable histoire de vie, de mort et d’amour, douce-amère, dans la tradition de Ghost et de Field of Dreams . » Le tout signé par… un grand auteur de science-fiction, Greg Bear.
Kindred Spirits commence de manière particulièrement sombre : un triste soir d’hiver, deux personnes se suicident. Un jeune homme, Michael Barrett, qui saute du haut d’un pont, et une jeune femme, Ginny, qui avale des médicaments. Tous deux font partie des perdants de la vie, de ceux hélas nombreux qui ne peuvent plus supporter de se sentir laissé au bord du chemin alors que Noël est une fête pour tant d’autres… Avec une délicatesse remarquable, Alan Brennert nous fait suivre les derniers jours de ses deux victimes, afin d’en brosser des portraits attachants. Sans lourdeur, sans surplus d’émotion, l’auteur met en scène la décision finale — et le réveil post-mortem de Ginny et Michael.
Car la vie n’en a pas terminé avec eux.
Alors qu’ils sont l’un comme l’autre étendus dans des lits du même hôpital — ou plutôt, que leur corps physique y repose, brisé, fatigué, mais non encore tout à fait éteint — Ginny et Michael se réveillent sous une forme quasi fantomatique. Corps astral, âme, esprit ? Qu’importe le nom que l’on peut donner à une telle manifestation, une chose demeure certaine : l’un comme l’autre peut toujours bouger dans le monde, faire en sorte que leur nouvelle enveloppe soit soumise ou non à la gravité, et même atteindre par moment de nouveau un état « solide ». Errants dans la ville, nos deux héros (quoique le terme semble un peu inadéquat) vont se rencontrer et tomber amoureux l’un de l’autre. Commence alors leur… après-vie, nouvelle vie, lune de miel… En tout cas : leur ré-apprentissage du monde.
La grande force d’Alan Brennert est d’avoir évité toute mièvrerie, dans un contexte qui s’y serait aisément prêté. Si Kindred Spirits est un roman bourré d’émotion, il ne s’agit pas de sentiments faciles, d’effets de pathos obtenus avec des méthodes éculées.
Là où un film hollywoodien, justement, aurait sans doute essayé de tirer des larmes, Alan Brennert joue une petite musique toute en finesse, infiniment humaine. En cela, il se compare forcément avec Jack Finney, l’autre grand spécialiste de la « fantasy posthume » (pour utiliser une étiquette forgée dans la Encyclopedia of Fantasy de Clute & Cie). S’inscrivant dans une tradition durable de la fiction américaine (notamment illustrée dans les années quarante par les films It’s A Beautiful Life, Here Comes Mr Jordan, Heaven Can Wait et bien sûr Portrait of Jennie, d’après le roman de Robert Nathan — le prénom de Ginny semble d’ailleurs un clin d’œil à ce classique), le roman de Brennert est une œuvre bouleversante, d’une justesse admirable.
Outre Finney, on peut également comparer Brennert à Peter S. Beagle : le premier roman de ce dernier, A Fine and Private Place, relevait lui aussi d’une « fantasy posthume » douce et touchante. Et tout comme Beagle, Brennert est un auteur parcimonieux : ce n’est qu’en 1990 qu’il donne son troisième roman.
Time and Chance (traduit en France chez Denoël « Présence », sous le morne titre L’Échange), fut comme son prédécesseur commercialisé aux États-Unis sous une atroce couverture de best-seller romantique. Et comme Kindred Spirits, il va bien au-delà de ce sous-genre commercial.
Richard Cochrane est un acteur new-yorkais, qui connaît un joli petit succès : il a tourné dans de nombreuses séries télé et de multiples téléfilms, ne cesse de faire des publicités et de jouer dans des pièces de théâtre — on et off Broadway. Sans qu’il soit une grande star, il arrive tout de même assez souvent qu’on le reconnaisse dans la rue. Il possède un superbe appartement donnant sur Central Park, il passe de femme en femme. La belle vie ? Pas vraiment, car Richard commence à être sérieusement fatigué des incessants castings et de l’incertitude liée à sa profession. Lorsque sa mère meurt soudainement, dans leur village d’origine, Richard se laisse submerger par les remords.
Rick Cochrane est tout à la fois le même homme et un autre : Rick est la version de Richard qui, dans un univers proche, a épousé son amie d’enfance, n’a jamais quitté son village d’origine, n’a jamais été acteur. Et Rick est amer. Pire : il cède de plus en plus souvent à des crises de rage impuissante, la colère en lui menace de le faire craquer.
Un soir, sous une pluie persistante, Richard et Rick vont se rencontrer. Et décider d’échanger leurs vies : Richard souhaite se reposer, trouver un amour stable et une famille confortable. Rick rêve de célébrité et de show-biz.
À l’instar de Jack Finney dans Le Voyage de Simon Morley, Alan Brennert parvient à broder une trame de « fantasy posthume » sans avoir à tuer ses héros. Prenant une idée que chacun d’entre nous a eu, un jour ou l’autre (« et si j’avais plutôt fait tel choix, quelle aurait été ma vie ? »), il bâtit le double récit d’une vie. Simple et complexe, comme toute vie humaine : les doutes, les bonheurs, les déchirements. La fantasy de Brennert (ou le fantastique, peu importe le terme que l’on choisit d’employer) ne fait jamais recourt aux mythes : son merveilleux est inhérent au quotidien de tout un chacun. Et par cette « évidence » même, il ne peut que nous toucher : sous couvert de fictions, Brennert parle de vous, de moi, de nous tous, forcément. Sans effets de manches, sans êtres surnaturels, sans horreurs indicibles : des vies, simplement, illustrées par un décalage. Pour faire une nouvelle comparaison, il convient de citer Replay de Ken Grimwood : les romans d’Alan Brennert sont tout aussi difficiles à catégoriser. Et tout fascinants.
Profitant de la sortie de L’Échange, l’éditeur américain de Brennert (Tor) publia en même temps en 1990 un recueil des rares nouvelles de l’auteur : Her Pilgrim Soul. Un recueil une fois encore difficile à classer, subtil et touchant, porté sur un merveilleux où le surnaturel semble n’être qu’une coïncidence heureuse. Portrait de huit moments précieux…
« Sea Change » : l’Américain John Ridley a été durant quelques années un chanteur avec un bon petit succès, avant que son inspiration ne le quitte Puis, subitement, huit ans plus tard, l’inspiration a de nouveau frappé à sa porte ! Nouvelle tournée en Europe — et à Rome, l’accident (on comprend lentement qu’il est devenu sourd). Retiré à Mykonos, il assiste avec fatigue et résignation au concert dans le bar où il dîne d’une jeune chanteuse grecque (Leucosia), apparemment talentueuse. Rentrant chez lui, John a l’occasion de tirer Leucosia d’une dispute avec un jeune homme. Ils commencent à sortir ensemble — Leucosia est étonnante de modestie, elle semble hésitante, manquer d’assurance, alors qu’elle est visiblement très bonne — pourquoi n’est-elle pas plus connue, alors, si elle est capable de provoquer une telle adoration dans son audience ? Lorsqu’elle part de Mykonos, John part avec elle. Voulant comprendre pourquoi Leucosia refuse de chanter ailleurs que dans des clubs minuscules, John découvre qu’elle est née… en 1922 ! Peu à peu, il obtient l’étrange vérité : Leucosia est née de l’union du dieu des rivières, Achelous, avec une muse. Telles des sirènes (dont elles ont joué le rôle durant un siècle, prisonnières sur une île perdue), Leucosia et ses deux sœurs ont le pouvoir de captiver les mortels avec leur chant… John est le premier homme qui tombe naturellement amoureux d’elle, puisqu’il est sourd. Mais arrive une bonne/mauvaise nouvelle : John n’est pas définitivement sourd, il peut être opéré d’une oreille… Proche de certaines ambiances d’Andrew Weiner, une vraiment très belle novella de fantasy, lente et tendre, douce-amère.
« Queen of the Magic Kingdom » : une femme entre deux âges se promène dans un parc d’attraction — visiblement Disneyland à Los Angeles. Elle se sent bien ici, voudrait y rester tout le temps — elle emprunte même une robe dans une réserve et se glisse au sein de la parade de Main Street USA. Venue de Tulsa, elle est veuve, et n’a bientôt plus d’argent. Elle s’accroche aux rêves artificiels de Disneyland comme à un royaume magique, réellement magique… Une nouvelle étrange et triste, sans magie réelle — et c’est bien sa force. Comparable à du Gardner Dozois, en moins sombre.
« Healer » : dans la cité qui sera bientôt connue sous le nom de Teotihuacàn, un prêtre a la vision du futur terrible qui attend sa civilisation après six siècles et demi de paix : l’invasion aztèque, la destruction… De nos jours, un jeune voleur, Jackie, s’introduit dans un musée d’art méso-américain, se fait tirer dessus par un garde et s’échappe de justesse, blessé à l’abdomen — mais le bijou qu’il a volé se met à luire et sa blessure disparaît totalement. Ayant décidé d’utiliser la pierre pour guérir les gens, Jackie (devenu Frère Jean) s’est laissé convaincre par son père adoptif de monter une religion comme il y en a tant aux USA — mais cette fois, en guérissant réellement les gens. Alternant le récit de la vie de » Frère Jean » et celui du prêtre amérindien, qui tente de sauver un tout petit peu de sa Cité promise à la destruction, en cachant les objets magiques qui permettaient à son peuple de vivre dans une paix totale, cette nouvelle est une fable superbe et touchante sur la vie et ses espoirs.
« Jamie’s Smile » : tout les ans, c’est l’anniversaire de Jamie. Jamie est un jeune homme liurdement handicappé : cordes vocales pas finies, pieds pas finies, mains délicates, visages blanc, tout en Jamie est trop fragile — résultat d’une exposition de son père à des radiations atomiques avant sa conception. Une nouvelle d’horreur sans le moindre surnaturel, et néanmoins terrifiante, glaçante : le monstre n’est pas Jamie, prisonnier de sa chaise roulante, mais bien ses parents, prisonniers de leurs rancœurs et de leur petitesse. Le narrateur, un artiste, n’est là que pour éclairer cette horreur quotidienne. Cette fois encore, la comparaison s’impose avec l’œuvre de Gardner Dozois (voir le « Petit maître de la science-fiction » in Bifrost n°17, février 2000).
« Steel » : Ken est l’homme de fer — littéralement : d’une force surhumaine, rien ne peut le toucher, le faire plier. Il vit une vie ordinaire, avec sa femme et ses enfants — presque ordinaire : car certains soirs il part voler dans le ciel. Et lorsqu’à nouveau un conflit russo-américain menace en Méditerrannée, il se trouve obligé d’arrêter les deux flottes. La vie de Superman de manière réaliste — voilà ce qu’est cette courte et belle nouvelle.
« The Third Sex » : Pat n’est ni une fille ni un garçon. Elle n’a pas de sexe, juste un pee hole, rien de plus. Toute son adolescence, elle souffre de cette différence — de ne pouvoir rien » faire » avec les garçons, non plus d’ailleurs qu’avec les filles. Mais lorsqu’un médecin lui propose de la transformer chirurgicalement, elle accepte d’abord puis s’enfuit de chez elle. Renonçant à l’opération, elle vit et travaille un peu partout aux USA, découvrant que son identité sexuelle ne se situe que dans le regard des autres : mâle pour l’un ou l’une, femelle pour un autre ou une autre, selon les moments et les situations… De plus en plus d’androgynes comme elle naissent, elle en rencontre quelques-uns, mais n’en éprouve pas vraiment de satisfaction. Jusqu’à ce qu’elle rencontre Davy, son amour d’adolescence — et sa femme Lyn. L’histoire touchante d’un(e) androgyne, parmi les première de son « troisième sexe », comme le précurseur d’un nouveau facteur d’harmonie entre les hommes et les femmes, et donc un facteur de nouvelle paix pour l’humanité. Une des seules incursions de Brennert en territoire science-fictif.
« Voices in the Earth » : une équipe d’exploration scientifique redécouvre la Terre, vide de toute vie et à l’atmosphère polluée par les produits chimiques agressifs, jaunie par la présence d’oxyde de fer. Dans les sous-sols de New York, un des prof voit des gens parler et vivre, mais ils sont tous curieusement translucides, comme des hologrammes. Et l’un d’eux l’interpelle : « vous ne vous souvenez pas de nous ? » demande-t-il. Il s’agit des fantômes restés sur terre après le départ de l’humanité. Maintenant, ils veulent rejoindre l’humanité dans les étoiles — mais le scientifique se défend, essaye de les empêcher, et leur propose finalement de réunir leur énergie pour revitaliser la terre, puisqu’ils sont les fantômes des humains qui ont détruit cette Terre, après tout… Et effectivement, pour la première fois depuis des siècles, il pleut de nouveau. Et des aminoacides apparaissent dans les océans… Belle fable, quoique limite naïve, « Voices of the Earth » est un agréable mélange de fantastique et de science-fiction.
« Her Pilgrim Soul » : Kevin est un scientifique, avec son assistant Daniel il a créé un hologramme, une simulation, représentant la Terre dans tous ses détails. Un soir, un fétus apparaît dans le faisceau lumineux en lieu et place de la simulation spatiale. Le lendemain, c’est une petite fille d’environ cinq ans qui est dans le simulateur. Une petite fille intelligente, réelle quasiment, pas seulement une simulation implantée dans l’ordinateur en guise de plaisanterie par un autre département. Et le petite fille se met à vieillir à raison de cinq mois par heure. Comme si l’ordinateur avait capturé l’âme d’une femme du début du siècle… Encore une novella bouleversante d’émotion et d’intelligence : la femme dans l’hologramme est revenue d’entre les morts pour le scientifique, parce que celui-ci est la réincarnation de son mari. Encore une fois, le thème frôle dangereusement l’eau-de-rose… en l’évitant parfaitement. L’auteur cite un moment Portrait of Jennie de Robert Nathan, décidément une référence pour lui.
Her Pilgrim Soul est un recueil que l’on peut comparer à ceux de Gardner Dozois (et un peu à ceux d’Andrew Weiner, mais sans l’humour de ce dernier) : peu de science-fiction, peu de véritable fantasy, plutôt une littérature générale étrange et personnelle, viscérale et émotive, aux personnages dépeints avec profondeur — et l’auteur a le talent de ne jamais sombrer dans le larmoyant, avec des sujets pourtant peu faciles à réussir. Le tout est globalement très beau, très touchant — tout en demi-teintes, en nuances… Un auteur aussi inclassable, à l’œuvre d’accès aussi subtil, peut-il réellement rencontrer un succès commercial ? Qu’importe : pour Alan Brennert la prose n’est visiblement pas affaire de réussite financière (pour ça, il a son activité télévisuelle) mais bien l’expression d’interrogations majeures, de doutes personnels et d’explorations quasiment intimes. Un travail d’écrivain exigeant, qui porte ses fruits : L’Échange est considéré par beaucoup comme une des œuvres majeures du fantastique moderne.
Depuis, Alan Brennert est passé au roman historique, avec tout d’abord un diptyque situé à Hawaï au début du XXe siècle, Moloka’i et Honolulu (2003 et 2009), puis avec Palisades Park (2013), situé aux États-Unis dans l’entre-deux-guerres.