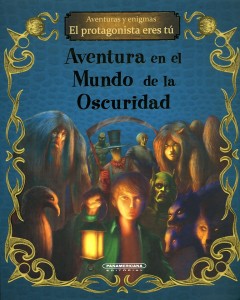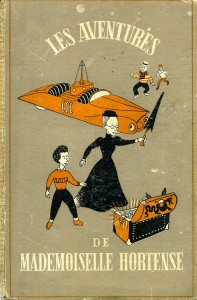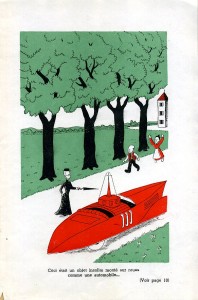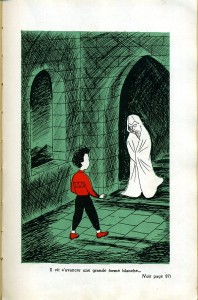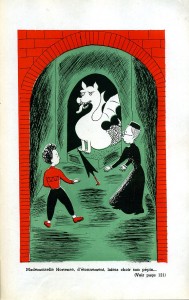Ce qui lia mes différents voyages, durant cette quinzaine nomade, curieusement ce fut la voiture : moi le piéton, moi le marcheur impénitent, je me suis retrouvé à participer au culte automobile. La Mnemosmobile est une « espace » confortable, je n’ai jamais eu mal au dos (ce qui m’arrive fréquemment en voiture), et j’ai redécouvert le charme particulier, désincarné, des voyages automobiles au long cours, cette glissade sans fin sur un ruban. De St. Malo à Lyon l’on traverse en autoroutes une France qui ne semble plus constituée que de forêts. Sous un ciel uniformément gris, dans une brume d’humidité qui monte de l’asphalte, les autoroutes filent entre deux vastes épaules vertes : forêts de pins, forêts de sapins, forêts de chênes, bermes herbeuses, quelques ouvertures sur des prés, notre pays paraît s’inscrire uniformément dans une nature domptée mais déserte. En fait, seulement en Auvergne, fort curieusement, l’urbanisme touche-t-elle une unique fois au ruban autoroutier. Des maisons, enfin, un instant. Partout ailleurs, la symphonie sans interruption des verts, vibrant d’autant mieux que la conjonction du printemps et du ciel plombé en rehausse les couleurs, gorgées d’eau. La route, elle aussi, a de ces nuances : bleu d’ardoise, noir d’encre, gris souris, rose brumeux.
Sur cette autoroute, la France devient abstraite. Villes et monuments se réduisent à leur plus simple et uniforme expression, celle d’un panneau de couleur brune, porteur d’un dessin stylisé. Autun ou Alesia, il ne s’agit que d’étapes chimériques, des concepts qui sous couvert de « repères » créent tout l’effet contraire : on ne sait plus où l’on se trouve, Autun ou Alesia ne sont que des noms, des panneaux, tous semblables. Et les cours d’eau, idem : la Mauvaise ou la Sansfond, ces noms évoquent fugitivement des images de divinités locales peu commodes, mais la plupart du temps on ne les aperçoit même pas, ce sont juste d’autres panneaux bruns, plus petits. Parfois, une halte : le véhicule ralentit dans les boucles bien dessinées d’une « aire », et à l’arrêt l’on constate que les bouleaux qui entourent des restaurants et stations-essences tous semblables semblent avoir autant de réalité qu’un motif de papier peint. Quant à la vie sauvage, elle aussi est devenue abstraction : des motifs sur quelques panneaux routiers, et le discret passage au-dessus de nos têtes de ponts bardés de bois d’où émerge la cime de quelques arbres, signalant qu’il s’agit d’endroits prévus pour la traversée des animaux d’un bord à l’autre. Rien ne saurait troubler le trajet, on file, on file. À la radio, la voix suave nous informe que la bonne nouvelle est qu’un accident est évacué, pas que des gens auraient survécu, seul importe que l’on roule, nous aussi nous sommes devenus théoriques.