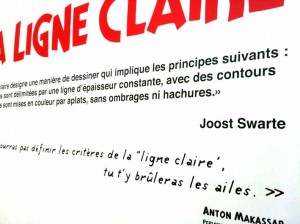Devant me rendre dans un coin lointain de la Croix-Rousse pour une réunion officielle (A.G. d’une agence culturelle qui vient de découvrir qu’elle a un trou de 813 000 euros dans ses caisses : long rire nerveux), j’en ai profité pour effectuer de très longues balades urbaines, à l’aller comme au retour. Je me rends bien compte qu’avec les années, je suis devenu fort casanier. Autrefois, dans mon jeune temps, j’étais continuellement rendu en centre ville et, cette fois, je me suis amusé à revisiter quelques parcours qui m’étaient très familiers à différentes époques. Les alentours de la Martinière, un quartier où j’ai toujours eu envie d’habiter ; le quai au-dessus duquel logeait mon ami Werner ; etc. Ai notamment emprunté un passage voûté très long, une sorte de couloir sous des immeubles anciens ; passage que, curieusement, j’ai intégré depuis longtemps à mon « paysage onirique » — mais que dans mes rêves de villes, je situe à Bordeaux. D’ailleurs, je ne rêve jamais d’une ville qui se nommerait Lyon, ce doit trop être mon réel. J’ai vu avec grand intérêt l’autre jour, sur le blog d’Alex Nikolavitch, que lui aussi visitait en songes des villes récurrentes, plus ou moins identiques à elles-mêmes d’un rêve à l’autre. Lorsque je fais de tels songes, il m’arrive même de me souvenir d’anciens rêves comme si c’était ma vie dans le passé — une sorte d’univers parallèle, où j’aurai notamment vécu étant étudiant dans un immeuble en fond de cour très différent de celui où je loge à Lyon, mais ne ressemblant pas non plus du tout à l’immeuble, un ancien bordel, (enfin, « ancien », c’est vite dit) près de Mériadeck, où je logeais effectivement pendant mes années estudiantines.
En rentrant, je suis passé devant une boulangerie curieusement nommée « Boulangerie contemporainE » (avec le grand E final), et comme je passais devant, la vendeuse demanda à un client: « Et si on coupe les pieds ? ». Un peu plus loin, d’une épicerie arabe un grand gaillard basané sortait avec dans la pogne une canne à pêche. People are strange.