Il n’y a pas longtemps, j’avais envie de relire des nouvelles de Zenna Henderson — et j’ai réalisé que l’intégrale Ingathering faisait partie des livres « empruntés » par une personne indélicate. Je l’ai donc racheté, ma foi. Et me suis souvenu avoir d’antan consacré un petit article à cette autrice…
Ils sont parmi nous : vieux thème de la science-fiction ! D’ordinaire, on pense que les extraterrestres ainsi introduits chez nous sont plutôt du type sournois et maléfique, d’affreux envahisseurs venus pour nous mentir et nous spolier. Pourtant la littérature de science-fiction a souvent parlé d’E.T. bénéfiques, de gentils paumés venus de l’espace…
Née près de Tucson, Arizona, en 1917, Zenna Henderson (née Chlarson) passa la plus grande partie de son existence comme maîtresse d’école dans les établissements scolaires de l’Arizona rural. Elle enseigna également en France durant deux ans, puis une année dans le Connecticut, et « en Arizona, j’ai enseigné dans un camp de déplacement de Japonais durant la Deuxième Guerre mondiale puis, bien plus tard, dans un camps militaire — Fort Huachuca. J’ai enseigné dans une ville minière à moitié fantôme, où les enfants devaient apporter des bouteilles d’eau parce que la pression de l’eau était trop faible pour monter jusqu’en haut de la colline où était située l’école. (…) De profession, je suis institutrice. De vocation, je suis écrivain. »[1]
Cet enracinement dans la campagne d’Arizona et dans la profession d’institutrice sont les bases de toute la carrière d’autrice de Zenna Henderson, qui durant plus de trente ans livra des nouvelles à la revue F&SF. Jamais elle n’écrivit de roman, rarement elle s’éloigna de ses racines : la quasi totalité de ce qu’elle écrivit tient en quatre petits recueils. Les histoires tournant autour de l’univers scolaire étaient la spécialité d’Henderson — elles lui permettaient une vaste gamme d’événements toutes vues à la fois par la sensibilité des adultes et par celle des enfants. Minimalistes dans leur cadre comme dans leur portée, ses nouvelles jouaient uniquement dans une gamme toutes en demi-teintes. Souvent marquées par une grande sentimentalité, elles pouvaient cependant être également cruelles, proche de l’horreur moderne.
Sa première nouvelle sortit en 1951 : « Come On, Wagon » (in F&SF, bien entendu). Et dés sa deuxième (« Ararat », octobre 1952), elle débuta le cycle pour lequel elle mérite de demeurer dans la mémoire de la science-fiction : les Chroniques du Peuple.
PERDUS SUR TERRE
Les habitants de Cougar Canyon ont beaucoup de mal à garder un instituteur. En fait, ils en changent chaque année, et bon nombre des enseignants qu’on leur a envoyé au fil des ans n’est jamais repartit de la petite bourgade : un secteur du cimetière local est réservé aux vieux instituteurs mort à la tache. D’ailleurs, cette année le rectorat a déclaré forfait : les dirigeants de Cougar Canyon ont du se débrouiller tout seuls pour trouver leur instit’, en faisant appel à une agence d’intérim de la côte.
C’est une jeune femme, cette fois, qu’on leur envoi : un changement agréable par rapport aux vieux bonshommes en fin de carrière auxquels Cougar Canyon a droit habituellement. Et puis, qui sait ? Peut-être une jeune personne sera-t-elle moins impressionnable qu’un presque-retraité ? Les enfants font ce qu’ils peuvent pour rester sages, mais c’est dur lorsqu’on est en petite classe de se souvenir qu’il ne faut pas léviter ni téléporter…
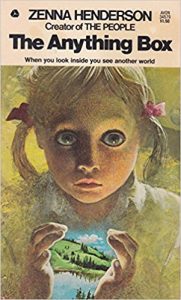 « Ararat » révèle la présence, dans les années 40, d’un petit groupe (je devrais plutôt écrire : Groupe) d’extraterrestres échoués sur Terre, suite à la destruction de leur vaisseau. Le Peuple, fuyant la destruction de sa planète d’origine, a voyagé dans l’espace à la recherche d’une nouvelle terre d’accueil, et l’un de leurs vaisseaux ayant connus des difficultés a explosé en vol au-dessus de l’Arizona. Une nacelle d’évacuation s’est écrasée contre le mont Baldy, dans l’immensité presque désert qui s’étend derrière le village de Kerry Canyon. Là, le Peuple a fondé Cougar Canyon — à l’écart des humains mais en imitant leur façon de vivre. Quasi semblables à nous, physiquement, ceux du Peuple se souviennent encore de la communion psychique de leur civilisation d’origine, et ils sont doués de divers pouvoirs parapsychiques (télépathie, télékinèse, etc). L’arrivée de la nouvelle institutrice, dans « Ararat », révèle à la petite communauté qu’il existe certainement d’autres membres du Peuple ailleurs, disséminés loin du refuge de Cougar Canyon, en but à la différence et obligés de cacher leurs Pouvoirs…
« Ararat » révèle la présence, dans les années 40, d’un petit groupe (je devrais plutôt écrire : Groupe) d’extraterrestres échoués sur Terre, suite à la destruction de leur vaisseau. Le Peuple, fuyant la destruction de sa planète d’origine, a voyagé dans l’espace à la recherche d’une nouvelle terre d’accueil, et l’un de leurs vaisseaux ayant connus des difficultés a explosé en vol au-dessus de l’Arizona. Une nacelle d’évacuation s’est écrasée contre le mont Baldy, dans l’immensité presque désert qui s’étend derrière le village de Kerry Canyon. Là, le Peuple a fondé Cougar Canyon — à l’écart des humains mais en imitant leur façon de vivre. Quasi semblables à nous, physiquement, ceux du Peuple se souviennent encore de la communion psychique de leur civilisation d’origine, et ils sont doués de divers pouvoirs parapsychiques (télépathie, télékinèse, etc). L’arrivée de la nouvelle institutrice, dans « Ararat », révèle à la petite communauté qu’il existe certainement d’autres membres du Peuple ailleurs, disséminés loin du refuge de Cougar Canyon, en but à la différence et obligés de cacher leurs Pouvoirs…
« Lorsque j’ai commencé à écrire « Ararat », le Peuple était supposé être un groupe étrange ayant traversé, par magie, l’océan Atlantique en tant que réfugiés d’une sorte de pays genre Transylvanie. Cependant, j’éprouvais des difficultés à écrire à propos de gens déplaisants, mes personnages devinrent donc de plus en plus « Peuple », jusqu’à ce que je laisse tomber mon idée d’origine et développe à la place le principe de réfugiés venus d’un autre monde. »[2]
Publiée au début des années 1950, cette nouvelle reflète l’intérêt de l’époque pour la parapsychologie — une discipline qui, étudiée scientifiquement depuis les années 20 (par William McDougall et le couple Rhine, en particulier), parviendra au devant de la scène intellectuelle dans les années 50 et 60. La parapsychologie trouvera une manière d’apothéose en 1969, avec son acceptation en tant que science par la Société des sociétés scientifiques américaines. Mais ensuite, entre positivisme triomphant et discrédit dû aux illuminés de tous poils, la recherche en parapsychologie se fera de nouveau très discrète. Toujours est-il que si, de nos jours et par peur d’un certain ridicule, peu d’auteurs osent encore parler de parapsychologie, le sujet était encore considéré comme valable dans les années 1950. De Theodore Sturgeon à Clifford D. Simak, en passant par Frank M. Robinson (The Power, 1956 ; un classique méconnu en France), nombreux sont les auteurs qui basèrent leurs œuvres sur le sujet de l’E.S.P. — ou des « psionics », pour utiliser le terme forgé par le bouillonnant responsable d’Astounding, John W. Campbell Jr. Chez Zenna Henderson, les enfants s’envolent, on gare les voitures dans les arbres et il n’y a pas besoin de se lever pour saisir un bouquin. L’autrice a même créé tout un vocabulaire spécialisé, souvent très poétique dans ce qu’il évoque — les membres du Peuple utilisent des rayons de soleil « noués » pour certaines de leurs actions, par exemple.
« Ararat » témoigne également d’une époque où les États-Unis voient encore cohabiter un mode de vie rustique, hérité du temps des pionniers, et le triomphe de la technologie. « Il n’y a jamais eu une nette dichotomie entre technophile et technophobe. Les intérêts des écrivains sont trop divers pour cela. Antithétique à la fois au souci ultra-technologique d’Analog et à l’emphase stylistique expérimentale de New Worlds, existait une école d’écriture que nous pourrions nommer la Pastorale Américaine Post-Technologie. Traditionnelle, confortable et profondément humaniste dans son approche, cette école est particulièrement bien représentée par trois auteurs, Clifford Simak, Edgar Pangborn et Zenna Henderson. Il y en a d’autres, bien sûr, mais ces trois là laissèrent leur marque sur la décennie, en publiant dans des magazines comme F&SF et Galaxy. Par leur influence, ils donnèrent à ces revues une bonne part de leur coloration particulière », explique Brian Aldiss dans son incontournable essai Trillion Year Spree. On peut ajouter, de plus, que les deux magazines en question étant ceux qui bénéficièrent d’éditions françaises (respectivement Fiction et Galaxie), cette école « pastorale » de la science-fiction nord-américaine est particulièrement familière aux lecteurs français.
Humaniste, la science-fiction pastorale ne rejette pas l’Autre : si les décors des Chroniques du Peuple rappellent fortement ceux de la série télé Les Envahisseurs, son idéologie est radicalement différente. En pleine guerre froide, la science-fiction de Zenna Henderson nous dit : acceptons les autres, reconnaissons la différence comme une richesse et non comme une séparation. Les extraterrestres du Peuple ne font pas peur : ils soignent, ils compatissent, ils accueillent — ils émerveillent. Je parlais, à propos de Rite de passage d’Alexei Panshin (chapitre quatre) du sense of sharing (sens de partage, sentiment d’émerveillement en découvrant les autres) par contraste avec le sense of wonder (émerveillement devant le monde extérieur) : l’œuvre d’Henderson en est un superbe exemple.
Les Chroniques du Peuple ont la grâce de l’évidence : qui n’a pas eu l’impression, un jour, de ne pas tout à fait faire partie de l’humanité ? Chez Henderson, ce fantasme est vrai — littéralement. L’autrice reçut d’ailleurs toute sa vie des courriers de lecteurs détraqués, la suppliant de leur dire où se trouve Cougar Canyon car ils sont du Peuple et veulent retrouver les leurs ! Pathétique, cette réaction est néanmoins symptomatique de l’attrait des Chroniques du Peuple : parlant de problèmes intimes, douloureux (différence, inadaptation sociale, rejet par les autres), elles sont de ce fait même… universelles.
RÉUNION
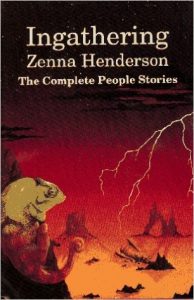 Les nouvelles suivantes de la Chronique du Peuple sortirent en 1954 (« Gilead »), 1955 (« Pottage »), 1957 (« Wilderness »), 1958 (« Captivity ») et 1959 (« Jordan »). Une nouvelle par an, même pas : miss Henderson n’était pas une autrice prolifique. Même en comptant les quelques fictions hors cycle qu’elle publiait entre temps. Chacune de ces nouvelle permet de mieux explorer l’univers fragile du Peuple sur Terre : le village de Bendo, qui vit dans le souvenir terrifié des massacres qui suivirent l’arrivée de ses habitants après le crash d’une des navettes (scènes de lynchage et de bûcher, les membres du Peuples arrivés dans la région furent traités comme des sorcières et vivaient depuis dans la négation de leur héritage, de leurs Pouvoirs, de peur de déclencher de nouveau la haine des gens de l’extérieur). Des enfants perdus, retrouvés. Et de nouvelles surprises : le Peuple et l’Humanité sont interféconds, et les Pouvoirs du Peuple ne disparaissent pas chez les enfants mixtes ; des enfants d’humains se découvrent même, seuls, des Pouvoirs identiques à ceux du Peuple — les Terriens seraient-ils sur la voie de l’évolution psychique qui fit du Peuple ce qu’il est ? Les six nouvelles forment le récit, éclaté et parcellaire, de la réunion des membres du peuple qui étaient éparpillés sur Terre. Jusqu’à l’arrivée, dans « Jordan », d’un vaisseau venu de New Home, la nouvelle planète découverte et aménagée par les autres Groupes du Peuple. Difficile choix : partir pour un paradis qui leur est parfaitement adapté — mais dont les habitants semblent terriblement détachés des choses matériels, coupés de la vie simple et du goût de la nature —, ou demeurer sur Terre — où sont désormais une partie de leurs racines, mais où la vie est difficile, hasardeuse…
Les nouvelles suivantes de la Chronique du Peuple sortirent en 1954 (« Gilead »), 1955 (« Pottage »), 1957 (« Wilderness »), 1958 (« Captivity ») et 1959 (« Jordan »). Une nouvelle par an, même pas : miss Henderson n’était pas une autrice prolifique. Même en comptant les quelques fictions hors cycle qu’elle publiait entre temps. Chacune de ces nouvelle permet de mieux explorer l’univers fragile du Peuple sur Terre : le village de Bendo, qui vit dans le souvenir terrifié des massacres qui suivirent l’arrivée de ses habitants après le crash d’une des navettes (scènes de lynchage et de bûcher, les membres du Peuples arrivés dans la région furent traités comme des sorcières et vivaient depuis dans la négation de leur héritage, de leurs Pouvoirs, de peur de déclencher de nouveau la haine des gens de l’extérieur). Des enfants perdus, retrouvés. Et de nouvelles surprises : le Peuple et l’Humanité sont interféconds, et les Pouvoirs du Peuple ne disparaissent pas chez les enfants mixtes ; des enfants d’humains se découvrent même, seuls, des Pouvoirs identiques à ceux du Peuple — les Terriens seraient-ils sur la voie de l’évolution psychique qui fit du Peuple ce qu’il est ? Les six nouvelles forment le récit, éclaté et parcellaire, de la réunion des membres du peuple qui étaient éparpillés sur Terre. Jusqu’à l’arrivée, dans « Jordan », d’un vaisseau venu de New Home, la nouvelle planète découverte et aménagée par les autres Groupes du Peuple. Difficile choix : partir pour un paradis qui leur est parfaitement adapté — mais dont les habitants semblent terriblement détachés des choses matériels, coupés de la vie simple et du goût de la nature —, ou demeurer sur Terre — où sont désormais une partie de leurs racines, mais où la vie est difficile, hasardeuse…
En 1961, l’éditeur Doubleday réunit ces six nouvelles sous forme d’un recueil : Pilgrimage: the Book of the People. Un lien narratif réunit de manière un peu artificielle les six textes — l’histoire de Lea, une jeune fille suicidaire recueillie par le Peuple lors d’une importante réunion de Souvenir. Irritante, Lea n’est visiblement qu’un prétexte, pas vraiment nécessaire. C’est ce recueil qui sortira en France chez J’ai Lu, sous le titre Chronique du Peuple. Toutes les nouvelles étaient déjà parues dans Fiction, mais Jacques Sadoul les fit retraduirent — les traducteurs de Fiction n’ayant notamment pas discerné les allusions bibliques des titres.
« J’avais du mal à trouver un titre pour la nouvelle. Je ne sais plus si c’est J. Francis McComas ou Anthony Boucher — ils étaient co-directeurs du magazine à l’époque — qui suggéra « Ararat ». Ce fut le début d’une suite d’idées qui mena à toutes les nouvelles du Peuple. (…) Les lecteurs non familiers avec la Bible ratent de nombreuses nuances des nouvelles du Peuple. Beaucoup de mes titres en viennent, et la plupart des noms de mes personnages. (…) Toute les nouvelles de Pilgrimage plus « Deluge » ont des thèmes tirés de l’Ancien Testament, appliqués à des individus ou à des petits groupes. »[3]
MATURITÉ
À en croire Brian Aldiss, Zenna Henderson fut ensuite atteinte de « sequelitis ». Jacques Sadoul[4] va même jusqu’à prétendre que « malheureusement, l’auteur ne voulut pas en rester là et donna de nombreuses suites à sa Chronique du Peuple, ce qu’il eût mieux valu qu’elle ne fît point. » Fidèle à cet opinion, Sadoul ne publia donc jamais le deuxième volume du cycle. Mais que l’on me permette de n’être pas (du tout) de cet avis.
De même que je regrette que monsieur Sadoul n’ait jamais publié les suites de la Patrouille du Temps de Poul Anderson (pour des raisons similaires, je crois), je trouve assez outrée l’opinion selon laquelle Zenna Henderson aurait trop écrit. Seize nouvelles (dix-sept avec l’inédite), est-ce tant que cela ? J’ose au contraire affirmer que les meilleurs textes de la Chronique du Peuple se situent dans la seconde partie du cycle. L’autrice y creuse avec plus d’acuité encore les questions d’inadaptation sociale, tout en diversifiant/élargissant un peu ses sujets. Servies par un style toujours moderne (élégant, débarrassé du superflu, prompt à brosser une atmosphère), ces nouvelles sont des trésors de grâce. D’autant que les bons sentiments y sont plus subtils que dans le premier cycle, la religion affaire purement personnelle (Henderson n’a jamais laissé ses textes être envahis de religiosité, bien que le Peuple croit en un dieu supérieur et prie comme les chrétiens) et les personnages plus mûres dans leur approche de la société (le premier cycle mettait surtout en scène des adolescents et des enfants : dans le second cycle ils ont grandis, pris de l’assurance et de la maturité).
En 1967, paru un deuxième volume américain : The People: No Different Flesh, qui réunissait les nouvelles « Return » (1961 ; « Le retour », in Fiction n°166), « Shadow on the Moon » (1962 ; « Ombres sur la Lune », in Fiction n°170), « No Different Flesh » (1965 ; « Des parents éloignés » in Fiction n°197) ; « Angels Unawares » (1966 ; non traduite) et « Troubling the Water » (1966 ; non traduite), assemblées à l’aide d’un récit sur « Mark & Meris ». Ce recueil-là ne fut jamais publié en France.
Zenna Henderson continua, à son rythme tranquille, à fournir de temps en temps des petites vues du destin du Peuple : « Deluge » en 1963 (« Les Éxilés » in Fiction n°174) ; « The Indelible Kind » en 1968 (« Ceux qu’on n’oublie pas » in Les Enfants de la nuit, Marabout) ; « That Boy » en 1971 (non traduite) ; « Katie-Mary’s Trip » en 1975 (non traduite), « Tell Us A Story » en 1980 (non traduite) et « Michal Without » (publié de manière posthume, en 1995, dans le recueil intégral de la NESFA Press ; non traduite).
La plupart de ses autres nouvelles firent l’objet de deux recueils : The Anything Box en 1965, et Holding Wonder en 1971 (traduit chez Marabout en 1975 sous le titre Les Enfants de la nuit)[5].
Zenna Henderson s’éteignit en 1983, emportée par un cancer. Elle n’avait que 66 ans. En 1991, un éditeur anglais fit un recueil intitulé The People Collection, qui réunissait quatorze des dix-sept nouvelles des Chroniques du Peuple. Il fallut attendre encore jusqu’en 1995 pour que la précieuse association NESFA fasse œuvre définitive en publiant Ingathering, qui voit enfin réunies en un seul énorme et beau volume les seize nouvelles des Chroniques du Peuple déjà connues, plus une nouvelle inédite, un petit papier autobiographique de l’autrice, et une chronologie.
D’apparence maintenant un peu désuète, la science-fiction de Zenna Henderson pourrait pourtant continuer de séduire des lecteurs : son message d’émerveillement et de tolérance ne saurait se démoder. Un seul auteur, à ma connaissance, a exploré depuis Henderson des voies vraiment similaires à celles des Chroniques du Peuple : Robert Reginald, dans son cycle des Elders. Surtout connu comme bibliographe et chroniqueur, cet auteur américain d’origine autrichienne livre de temps à autres de belles nouvelles mettant en scène une lignée parallèles des bommes, dont les membres sont dotés d’une très longue vie. Les Elders peuvent décéder de mort violente comme les hommes normaux, mais ne sont jamais atteints par la maladie et ne vieillissent que de manière extrêmement lente. Leur principal ennemi semble être l’ennui et les troubles comportementaux qui s’y rattachent : désespoir, repli sur soi, amnésie — et même suicide. Cachés en petite communautés discrètes (par exemple au fin fond du Tennessee rural) ou vivant au sein des hommes en changeant régulièrement d’identité, les Elders sont souvent des artistes — et comme tel doivent également se méfier de la célébrité. Quatre belles nouvelles de ce cycle se trouvent réunies dans le recueil Katydid & Other Critters (Ariadne Press, 2001).
[1] In « The People Series », seul article rédigé par l’autrice sur sa carrière (réédité in Ingathering, NESFA Press).
[2] op. cit.
[3] op. cit.
[4] In Histoire de la science-fiction moderne, 1973.
[5] Le lecteur francophone curieux pourra trouver d’autres nouvelles de Zenna Henderson, hors cycle, dans Fiction n°37, 46, 104, 126, 149, 204 et 271, Mystère Magazine n°104, Galaxie (première série) n°39, Marginal n°4 et l’anthologie Enfants rouges (Juillard).


