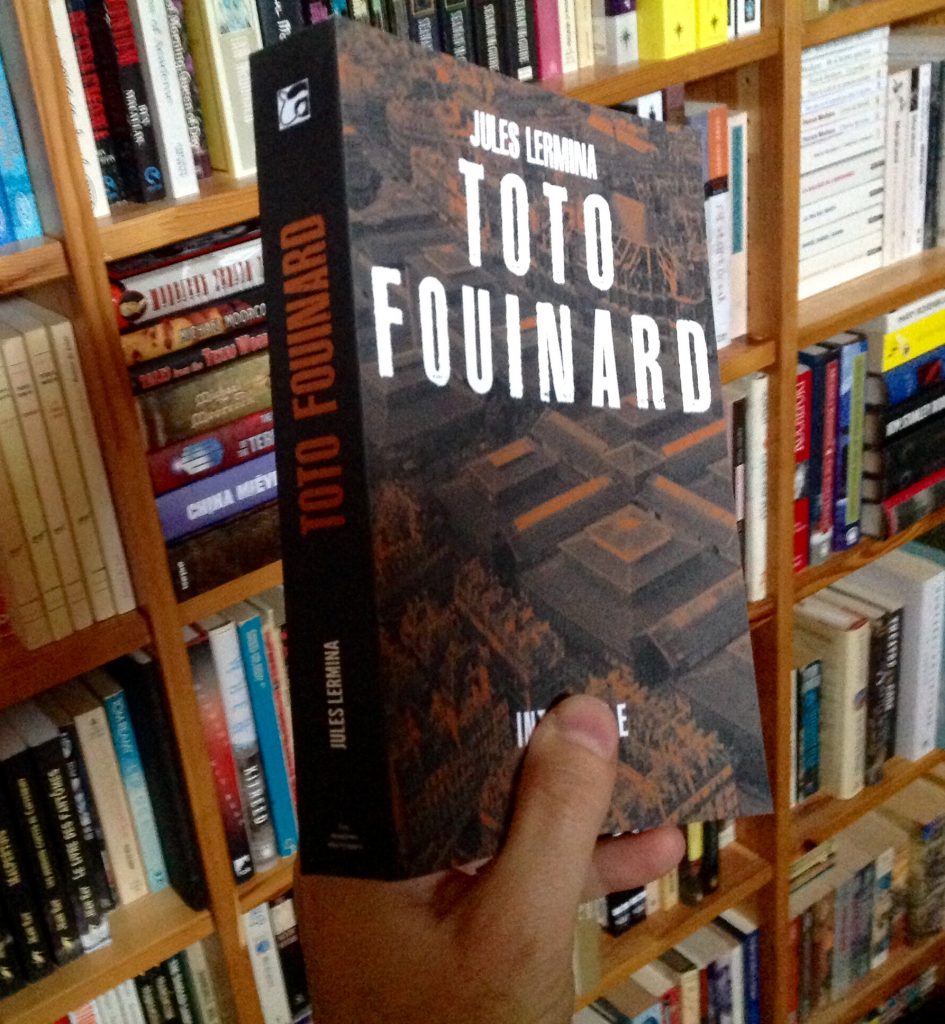Un grand monsieur de la SF US vient de partir. Hommage.
GARDNER DOZOIS : LE SOMBRE ÉCLAT
Gardner Dozois (prononcer son nom à la française : do-zoa) commence à écrire très jeune : né en 1947 c’est à l’âge de 17 ans qu’il vend sa première nouvelle, « The Empty Man ». Publiée deux ans plus tard dans If (en septembre 1966), cette nouvelle lui vaut aussitôt une nomination au prix Nebula. S’étant engagé dans l’armée comme journaliste militaire (il séjourne en Allemagne de 1966 à 1969 — d’où, plus tard, de fréquentes références à ce pays dans ses fictions), Dozois est silencieux durant quatre années, mais dés son retour aux États-Unis il se remet à écrire. Pour vivre, il intègre le comité de lecture de deux éditeurs de livres de poche, ainsi que celui des magazines du groupe Galaxy.
AU SEIN DE LA NOUVELLE VAGUE
Une mouvance passionnante existe à l’époque, pour laquelle le sigle SF ne signifie plus « science fiction » mais bien « speculative fiction ». Dozois s’inscrit en plein dans cette révolution : « admirateur de Gene Wolfe, Ursula Le Guin, Kate Wilhelm et James Tiptre Jr. (à qui il a consacré une étude passionnante chez Gregg Press en 1977), il oscille entre SF et mainstream, traitant du racisme, du Viet-Nam, des conditions sociales, de l’angoisse existentielle. » (Pierre K. Rey in La nouvelle Science Fiction américaine, 1981). Propice au développement de la fiction spéculative sont alors toute une série d’anthologies périodiques : Universe, Orbit, New Dimensions, Berkley Showcase, Chrysalis… Dozois y publie une série de nouvelles brillantes et remarquées — mais peu commerciales car très exigeantes (il aura cinq nominations au Nebula, trois au Hugo, et aucun prix). L’essentiel en est repris en 1977 dans le recueil The Visible Man (aujourd’hui difficilement trouvable) puis en 1992 dans Geodesic Dreams.
LES REVES GÉODÉSIQUES
C’est au sein du recueil Geodesic Dreams que peut se trouver un bon échantillon des fictions courtes de Gardner Dozois — qui constituent le principal de son œuvre d’écrivain. « Beaucoup d’écrivains de science-fiction, y compris beaucoup des grands auteurs du genre, se contentent d’être de simples raconteurs d’histoires, utilisant n’importe quel assemblage de mots qui peut s’avérer utile pour convoyer leur sens. Dozois est un raconteur d’histoires, également, et pas des moindres (…) mais il s’intéresse autant à la manière dont il raconte ses histoires qu’aux événements qu’il y décrit. » écrivait Robert Silverberg dans l’introduction à ce recueil.
Car Gardner Dozois est, peut-être avant tout, un grand styliste. Dans un genre effectivement peu soucieux de style en général, Dozois apparaît comme un « formaliste ». Pour autant, ses nouvelles sont la plupart du temps aussi de belles histoires : « Enfant du matin » (dans Univers 1986, j’ai Lu) n’aurait aucun sens, et ne provoquerait aucun choc, si narration et thème n’étaient pas intimement liés — lentement, la vérité sur les deux hommes présentés se fait jour, d’une cruauté terrible sans une apparence d’innocence.
Car Dozois n’est pas un mec rigolo, c’est clair : la plupart de ses nouvelles sont noires, très noires. Elles percent et déchirent, glaçantes. Pour une « Stray » (non traduite — dont l’humour bon enfant, sur une femme recueillant une licorne comme l’on recueillerait un chat errant, doit certainement beaucoup à Susan Casper), combien de « Permission de sortie » (in Proxima n° 8 — la confrontation entre un politicien cynique et l’assassin de son fils unique, sur fond de dictature bien-pensante), de « Expiation » (in Univers 1990, J’ai Lu — un ancien tortionnaire cherche le pardon auprès d’un psy), de « Apaisements » (in antho Asimov présente chez Pocket — où un jeune garçon innocent, conditionné, se prépare à être sacrifié) ou de « Chains of the Sea » (non traduite — la fable tranquillement cruelle d’un petit garçon capable de parler avec les autres êtres intelligents peuplant notre Terre — sur d’autres plans à peine décalés du nôtre — et des soucoupes volantes venues un jour discuter avec les vrais habitants de cette planète)… À mon sens, Dozois est un auteur d’horreur — mais l’horreur considéré comme un traitement, pas comme un genre : SF ou fantastique, peut lui importe l’étiquette sous laquelle on serait susceptible de classer ses nouvelles. Le plus souvent, elles sont même inclassables : voir le terrifiant et totalement étrange « Un royaume en bord de mer » (in Univers 1982, J’ai Lu).
DU CÔTÉ DE LA FORME LONGUE
Gardner Dozois est essentiellement un nouvelliste : il a cependant publié deux romans. Le premier, en 1975, était une collaboration avec un autre spécialiste de la fiction spéculative de l’époque : Geo Alec Effinger.
Lors de sa parution initiale, Nightmare Blue provoqua une considérable déception chez les critiques : comment ça, deux jeunes loups de la fiction spéculative qui écrivaient ensemble un roman de science-fiction classique ? Voilà qui « démontre une dangereuse facilité de la part des deux auteurs » nous déclare encore aujourd’hui l’assez snob John Clute dans son Encyclopedia of SF. Le fait est que Nightmare Blue est un roman de pure aventure, mais quel mal y aurait-il à ça ? Il est très plaisant, avec tous les atouts que l’on peut attendre des meilleurs « petits maîtres » : à savoir rapidité d’action, utilisation intelligente de thématiques mineures de la SF, bonne intrigue policière, écriture simple mais efficace. Plus un humour bien venu, des trouvailles astucieuses, quelques fortes scènes émotionnelles et un excellent suspense. On pense à du Lloyd Biggle Jr. (en plus noir), à du Zelazny de bonne facture, ou… à du Effinger moderne ! Car, depuis, le turbulent jeune homme qu’était alors Geo Alec Effinger est devenu un remarquable auteur de romans d’aventures : voir sa jubilatoire série du Privé de désert (chez «Présence du Futur»).
D’ailleurs le personnage principal de Nightmare Blue, Karl Jaeger, est un détective privé. Le dernier détective privé de la Terre, dans un vingt-et-unième siècle voué aux grandes entreprises aussi bien privées que fédérales. Il a été embauché par un milliardaire pour enquêter sur l’enclave extraterrestre qu’ont créé en Allemagne les Aensalords. Il n’en réchappe de d’extrême justesse ! Rentré à son agence, il consulte la presse et constate que rien ne filtre dans les médias des activités des E.T., alors que ceux-ci terrorisent la région où ils sont installés.
Parallèlement, un extraterrestre esclave des Aensamasters mène une enquête de son côté, au sein de la forteresse des E.T. Ressemblant à un mélange de crustacé et de pieuvre, Corcail Sendijen appartient à une élite qui semble bien décidée à débarrasser l’univers civilisé de la menace aensalord. Mais pour cela, Corcail doit trouver la source de la drogue qui permet aux Aensalord de mener l’univers par le bout du nez. Trois hauts fonctionnaires de l’ONU viennent voir Jaeger à son agence : ils veulent l’embaucher parce que le gouvernement mondial est totalement corrompu, ils ne peuvent plus faire confiance à personne dans les sphères dirigeantes. Une drogue, provenant des Aensalord, asservi les puissants de la Terre : administrée une seule fois, cette drogue provoque une addiction immédiate. Elle est mortelle, si l’on cesse d’en prendre. Et les Aensamasters en ont administré à tous les dirigeants ou presque… De plus, trois vaisseaus spatiaux surpuissants menacent la Terre, en cas de révolte. La mission de Jaeger : retourner dans l’enclave E.T., découvrir la source de la drogue, et la détruire. Une mission quasi-impossible, qu’il accepte pourtant…
L’autre roman de Dozois, Strangers (1978 ; en français, L’Étrangère, réédité chez ActuSF), rencontra un meilleur succès d’estime — et sa réputation n’a cessée de croître depuis. À juste titre.
Joseph Farber est un artiste terrien, qui est venu se perdre sur la planète Lisle — une planète où la Terre n’a qu’un minuscule comptoir, comme autrefois les Blancs venaient s’installer sur les côtes de la Chine impériale. D’ailleurs Lisle s’appelle Weinunnach dans la langue dominante des indigène (les Cian) : les Terriens ne sont pas les meilleurs diplomates qui soient, leur travestissement du vrai nom de leur monde d’accueil n’est qu’une des nombreuses facettes du mépris dans lequel ils tiennent leurs hôtes. Qu’importe : l’arrogance dérisoire des Terriens amuse les Cian, qui ont tendance à se foutre d’eux plus souvent qu’à leur tour lors des prétendus échanges de biens… Si les humains souffrent d’un net complexe de supériorité, dûe au traumatisme de l’entrée de la Terre dans le commerce galactique, les Cian pour leur part vivent sereinement, dans une société qui a toutes les apparences d’un haut niveau culturel et social.
Jamais avant la fête de l’Alàntene, Farber n’était sortit de l’Enclave terrienne. Pourtant, son job est d’enregistrer des paysages extraterrestres afin d’en tirer des sortes de tableaux/photographies subjectives, qui font fureur sur Terre. Indolent, Farber s’est laissé enfermé dans la routine de l’Enclave, sa première excursion en territoire indigène lui apparaît donc comme une sorte d’épreuve initiatique. D’autant que l’Alàntene est une fête religieuse, à peu près incompréhensible pour les étrangers. Incompréhensible ? Certes, pour les Terriens qui demeurent à l’extérieur des festivités et se droguent pour éprouver des sensations inédites, mais Farber pénètre dans la foule en extase et ne tarde pas à ressentir, lui aussi, l’étrange attraction d’un rituel qui pulse dans la population entière de la planète. Secoué, Farber se retire dans un abri élevé par et pour les Cian — c’est là qu’il va rencontrer Liraun Jé Genawen, une belle femme, une superbe indigène, avec laquelle il va bientôt tenter de faire sa vie. Mais comment peuvent s’entendre des amants aussi étrangers l’une à l’autre ? D’autant que, si la société extraterrestre semble assez tolérante, il n’en va pas de même des colons terriens, mesquins et racistes. Entre incompréhension intime et rejet social, le couple va faire son chemin, plongeant aux tréfonds de la psyché de deux civilisations qui s’ignoraient jusqu’à lors.
Rarement avant L’Étrangère un auteur avait-il tenté de brosser le portrait véritablement exhaustif d’une civilisation extraterrestre. Et lorsque je dis extraterrestre, je ne parle pas de l’exotisme à la Jack Vance, mais d’une vraie construction intellectuelle et ethnologique. Quant à l’approche purement intime du problème, elle n’était rendue possible, bien entendu, que par l’avènement de la spéculative fiction. Le résultat fut une œuvre bouleversante, à mon avis l’un des tout grands romans de SF du siècle. L’attention au décor, le lyrisme des descriptions, la beauté de la langue et des ambiances, ont rarement été égalés dans notre genre de prédilection. Je ne vois guère que Philip Mann, dans L’œil de la Reine (chez Denoël), qui soit allé aussi loin dans la xénologie, et Elisabeth Vonarburg, dans Tyranaël (chez Alire) qui ait poussé plus loin encore la construction d’une ville étrangère crédible… En relisant L’Étrangère, presque dix ans après ma première lecture, j’ai réalisé combien d’éléments de ce roman m’avaient marqués, profondément.
TRAVAIL À PLUSIEURS MAINS
La science-fiction, contrairement à toutes les autres formes de littérature, a une véritable tradition d’écriture de plusieurs auteurs en collaboration. On pense bien sûr au travail d’H.P. Lovecraft (entre directeur littéraire et nègre) pour de nombreux de ses contemporains, ou à la carrière commune de Catherine L. Moore et Henry Kuttner (sous le pseudonyme de Lewis Padgett). Du côté de la fiction speculative fiction, Harlan Ellison entama des collaborations avec de nombreux écrivains — la matière du recueil Partners in Wonder (1971). De notre côté de l’Atlantique, Jean-Pierre Andrevon l’imita avec brio dans les deux recueils Compagnons en terre étrangère (chez «Présence du Futur» en 1979), tandis que Michel Jeury multipliait les œuvres collectives.
Non content d’avoir signé avec Geo Alec Effinger un roman complet, Gardner Dozois continua au cours des années à collaborer sur des nouvelles avec des copains (Michael Swanwick, Jack Dann, Jack C. Haldeman II) et avec son épouse (Susan Casper). La plupart de ses œuvres à plusieurs mains firent en 1990 l’objet d’un luxueux recueil, Slow Dancing Through Time, chez le petit éditeur Mark V. Ziesing.
C’est également avec Jack Dann (un écrivain méconnu de la speculative fiction, revenu sur le devant de la scène en 1995 avec The Memory Cathedral, une monumentale « histoire secrète » de Léonard de Vinci) que Gardner Dozois fera ses premiers pas en tant qu’anthologiste : après A Day in the Life, en solo en 1972, il produira Future Power avec Dann en 1976 puis une très longue suite d’anthologies thématiques (existant encore aujourd’hui), allant piocher dans les revues la matière de recueil sur les chats, les licornes, les aliens, les dinosaures, les anges, etc etc.
TROP OCCUPÉ POUR ÉCRIRE
L’œuvre de fiction de Gardner Dozois est relativement limitée mais sa place dans la science-fiction américaine est cependant incontournable. Ce paradoxe s’explique par son travail éditorial.
Sur la foi de ses premières anthologies, Dozois se voit confier en 1977 la direction du Best Science Fiction of the Year de l’éditeur Dutton, à la suite de Lester Del Rey. Dozois dirige cinq volumes de ce best of de l’année avant que la série ne soit abandonnée. Un nouvel éditeur, Bluejay Books, lui propose en 1984 de reprendre ce type de travail : c’est la naissance des colossaux Year’s Best Science Fiction, une collection qui, reprise par Tor à la faillite de Bluejay, se poursuit encore de nos jours — elle est devenue absolument incontournable pour qui veut savoir ce qui se fait dans le domaine de la nouvelle (à noter que l’édition anglaise s’intitule Best New SF). Dozois y sélectionne le meilleur des nouvelles, bien entendu, mais présente également un panorama de l’évolution du genre au cours de l’année (dans des préfaces remarquables d’acuité), et propose une liste de nouvelles non-retenues pour publication dans le Year’s Best mais néanmoins intéressantes.
Parallèlement à cette entreprise, Gardner Dozois préside depuis la fin de 1985 à la destinée d’une des principales revues de SF aux États-Unis : Isaac Asimov’s SF (si ce n’est LA principale revue, d’ailleurs…). Il reçoit en 1988, 1989, 1990 et 1991 le prix Hugo du meilleurs directeur littéraire. Son influence sur le domaine est immense mais, et c’est là sa force, non dirigiste : Dozois ne privilégie pas une forme de SF par rapport à une autre, il n’a pas les obsessions mono maniaques d’un Campbell autrefois. Même la fantasy — quoique ce genre soit plutôt plutôt l’apanage des revues concurrentes F&SF et de Realms of Fantasy — trouve place dans les pages d’Asimov’s. En fait, Dozois ne choisit des nouvelles que sur la foi de leur qualité littéraire intrinsèque, sans souci de genre — une diversité de choix qui ne lui a jamais été reproché même par les fans les plus conservateurs. Témoin de cette sûreté de choix, le nombre de Hugo et de Nebula raflé chaque année par Asimov’s.
Enfant de la « spéculative fiction », Gardner Dozois est allé bien au-delà de cette mouvance et il n’est pas trop fort de dire que la science-fiction aurait été très différente sans son travail.
Première version publiée in Bifrost n°17, février 2000.
© André-François Ruaud, tous droits réservés.