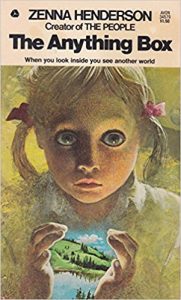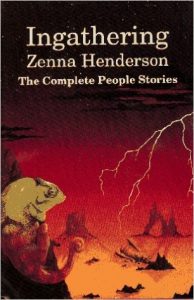Suite de l’exhumation d’articles d’il y a une vingtaine d’années… Le capitaine ne rajeunit pas…
L’un des moteurs habituels de la science-fiction est la volonté des hommes d’aller dans les étoiles et d’y découvrir d’autres formes de vie — et même de préférence, d’autres intelligences. Le genre est riche en extraterrestres excentriques, de toutes tailles et de toutes couleurs, mais certains auteurs préfèrent penser que l’humanité ne peut avoir qu’un seul visage, quelque soit son lieu de naissance.
La science-fiction s’enorgueillit d’avoir toujours compté dans ses rangs bon nombre d’écrivains qui sont également des scientifiques — mais il s’agit le plus souvent des disciplines « dures » de la science : astronomie, physique, chimie… Chad Oliver demeure, à ce jour, l’unique anthropologue du genre.
UNE VIE D’UNIVERSITAIRE
Né en mars 1928 d’un père chirurgien et d’une mère peintre, Symmes Chadwick Oliver fut un sportif assidu dans son enfance, jusqu’à ce qu’une fièvre rhumatisante menace de le tuer à l’âge de douze ans. Alité, le jeune Chad se mit à dévorer des ouvrages de science-fiction : Jules Vernes, H.G. Wells, Edgar Rice Burroughs et les pulps alimentèrent son imaginaire. Il arrosa abondamment le courrier des lecteurs de ces dernières publications.
La famille Oliver quitta l’Ohio pour le Texas durant la seconde guerre mondiale. Entre temps, Chad s’était remit au football. Il entra en 1945 à l’Université du Texas à Austin, où il étudia la littérature et l’anthropologie. Il passa ses diplômes dans cette dernière matière en 1951 et 52. Il se maria en novembre 1952 avec Beje Jenkins, à Los Angeles, où le couple résida jusqu’en 1955. Durant deux ans et demi, Chad Oliver forma de solides liens d’amitié avec quelques autres écrivains de la région de Los Angeles, Richard Matheson, Charles Beaumont et William F. Nolan. Oliver retourna à Austin en 1955, diplôme en poche (un PhD d’anthropologie), pour prendre un poste d’enseignant à l’Université du Texas. Il ne quitta plus jamais cet établissement, de promotion en promotion. Durant toutes ces années, il mena également des recherches anthropologiques, au Kenya et ailleurs en Afrique de l’Est. Il publia de nombreux articles et quelques ouvrages sur le sujet.
Chad Oliver est décédé en août 1993, à l’âge de 65 ans.
LES DÉBUTS D’UN ÉCRIVAIN
Amateur de science-fiction depuis son plus jeune âge, Chad Oliver proposa très tôt des récits aux diverses revues de science-fiction existant alors. Il n’avait que 22 ans lorsqu’il vendit sa première nouvelle, « The Land of Lost Content » (dans Super Science Stories, en 1950), et son premier roman ne tarda pas à suivre, en 1952. Il s’agissait d’un roman de SF pour jeunes, Mists of Dawn. Simple histoire de voyage dans le temps, ce roman d’aventure s’intéressait aux débuts de l’humanité avec finesse et sympathie. Si ce roman n’a rien de très mémorable, il fut néanmoins le premier d’une collection de science-fiction (chez Winston) qui marqua plus d’un jeune lecteur américain.
LA TRILOGIE EXTRATERRESTRE
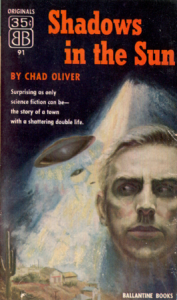 Le premier roman notable de Chad Oliver paru en 1954 : Shadows in the Sun (Ombres sur le soleil — paru chez Denoël «Présence du futur»). Depuis deux mois, Paul Ellery étudie la petite communauté tranquille de Jefferson Springs, Texas. Une petite ville comme beaucoup d’autres aux États-Unis, peuplée de 6000 âmes banales, desservie par le chemin de fer, organisée autour de sa rue principale, informée par un médiocre journal local… Une bourgade typique. Sans histoire. Tellement typique, tellement sans histoire, que l’anthropologue commence à se poser des questions : Jefferson Springs, Texas, est tellement normale qu’elle en est anormale ! Alarmé par des signaux subtils que seule sa formation lui permet de détecter, Ellery décide de fouiller un peu plus sous la surface des choses. Pourquoi toute la population de Jefferson Springs, Texas, est-elle arrivée dans ces quinze dernières années ? Pourquoi n’y a-t-il pas une seule lumière allumée après 9 h du soir ? Quelles sont ces étranges lampes bleues qui brillent dans les salons la nuit ? Quelles sont les réunions auxquelles il n’est pas invité ? L’étonnante vérité ne tarde pas à apparaître à Ellery : Jefferson Springs, Texas, est peuplée d’extraterrestres parfaitement intégré. Quelle sorte d’invasion est-ce là, si invasion il y a ?
Le premier roman notable de Chad Oliver paru en 1954 : Shadows in the Sun (Ombres sur le soleil — paru chez Denoël «Présence du futur»). Depuis deux mois, Paul Ellery étudie la petite communauté tranquille de Jefferson Springs, Texas. Une petite ville comme beaucoup d’autres aux États-Unis, peuplée de 6000 âmes banales, desservie par le chemin de fer, organisée autour de sa rue principale, informée par un médiocre journal local… Une bourgade typique. Sans histoire. Tellement typique, tellement sans histoire, que l’anthropologue commence à se poser des questions : Jefferson Springs, Texas, est tellement normale qu’elle en est anormale ! Alarmé par des signaux subtils que seule sa formation lui permet de détecter, Ellery décide de fouiller un peu plus sous la surface des choses. Pourquoi toute la population de Jefferson Springs, Texas, est-elle arrivée dans ces quinze dernières années ? Pourquoi n’y a-t-il pas une seule lumière allumée après 9 h du soir ? Quelles sont ces étranges lampes bleues qui brillent dans les salons la nuit ? Quelles sont les réunions auxquelles il n’est pas invité ? L’étonnante vérité ne tarde pas à apparaître à Ellery : Jefferson Springs, Texas, est peuplée d’extraterrestres parfaitement intégré. Quelle sorte d’invasion est-ce là, si invasion il y a ?
Ombres sur le soleil fit une forte impression lors de sa sortie originale, et s’installa d’emblée dans l’imaginaire science-fictif comme un apport marquant pour le genre. Voici un roman de science-fiction qui, en 1954, osait porter au premier plan les préoccupations et la psychologie de son personnage principal. Dans un genre qui, en dépit des œuvres de Theodore Sturgeon ou de Clifford D. Simak, préférait toujours les grands déploiements de décors, les vues globales et les destins collectifs, l’approche minimaliste d’Ombres sur le soleil avait de quoi marquer les esprits. Tout comme était original le choix de l’anthropologie comme approche scientifique du problème posé par l’intrigue de ce roman. Et tout comme semblait nouvelle l’idée selon laquelle « si l’homme de la Terre n’est effectivement pas seul, c’est la race humaine dans sa globalité qui est unique.[1] » En effet, les extraterrestres d’Oliver sont parfaitement humanoïdes : « La galaxie (…) comptait un grand nombre de planètes semblables à la Terre, de petites planètes peu spectaculaires, tournant autour de soleils tout à fait ordinaires. Sur chacune, la mystérieuse alchimie de la vie avait effectué des miracles au sein des mers (…). Les détails différaient souvent, mais le plan d’ensemble était le même. Une planète identique à la Terre engendrait un homme identique à l’homme terrestre. Ce n’était pas un simple hasard, mais le résultat d’une série de conditions données. »
Lors de la réédition du roman outre-Atlantique dans les années 80, Harlan Ellison déclara qu’il avait toujours admiré Shadows in the Sun, qui lui semblait être le premier roman véritablement New Wave, ce bien longtemps avant la New Wave. En effet, si le talent d’Oliver de « toucher au cœur du problème humain » (selon Damon Knight) existait également chez quelques autres auteurs (on pense inévitablement à Simak et autres auteurs de la science-fiction « pastorale » — mais surtout à Zenna Henderson : la petite ville de Jefferson Springs pourrait aussi bien être un havre du Peuple), la manière dont il expose dans ce roman le cheminement mental de son héros, ainsi que la conclusion douce-amère et indécise de l’intrigue, préfigurent indéniablement la « speculative fiction » qui fit les beaux jours des années 1970.
Oliver poursuivit sa réflexion sur la condition d’extraterrestre — sur l’aliénation et l’identité — au fil de ses trois autres romans de science-fiction. Les critiques ont pris l’habitude de considérer que Unearthly Neighbors (1960) et The Shores of Another Sea (1971) forment avec Shadows in the Sun une trilogie thématique.
Unearthly Neighbors est un autre roman de Chad Oliver qui frappe aujourd’hui par son caractère pionnier : le lecteur d’œuvres plus récentes comme L’œil de la reine de Philip Mann (Denoël), Contact de Carl Sagan (Mnémos) ou Le Vol du moineau de Mary Doria Russell (ActuSF) se doute-t-il qu’en 1960 un écrivain texan nommé Chad Oliver était déjà passé par là, qu’il avait déjà envisagé et traité à merveille le thème de la réception d’un message extraterrestre et de la mission anthropologique de premier contact ? Dans Unearthly Neighbors, une expédition est montée pour approcher le peuple humanoïde de Sirius 9, expédition menée par l’anthropologue Monte Stewart. Les extraterrestres sont un peuple primitif, vivant dans les arbres et dans des cavernes, mais possédant un véritable langage et une société complexe. Au début, les choses se passent plutôt tranquillement — jusqu’à un soir fatal, où les extraterrestres attaquent le campement terrien et massacrent la majorité des scientifiques. Que c’est-il passé ? Quel est le rôle des chiens-loups domestiqués par les extraterrestres ? S’immergeant totalement dans cette culture fondamentalement « autre », Monte Stewart découvrira les secrets d’une évolution à la fois si proche et si éloignée de la notre.
The Shores of Another Sea débute comme un mélange de roman colonial et de roman d’angoisse. Patron d’un élevage de babouins, en Afrique, Royce Crawford est inquiet : il ne sait pas exactement pourquoi, mais il a vaguement l’impression d’être surveillé. Un soir, une lueur blanche déchire le ciel, pour aller s’écraser quelque part dans la savane. Et le lendemain, des babouins commencent à disparaître : cages éventrées, babouins enlevés, babouins démembrés… Quelle force est en œuvre, qui menace l’univers tranquille de Royce ?
Largement autobiographique, parsemé de considérations sur l’écologie, le rapport avec la nature, la chasse et les hommes, écrit d’une plume élégante, The Shores of Another Sea s’avère peu à peu mener son lecteur vers une nouvelle facette de la thématique du contact avec les extraterrestres. Pour faire une analogie avec des auteurs récents, The Shore of Another Sea serait quelque chose comme un roman de Mike Resnik rédigé par Andrew Weiner. Tension, poésie, sens du paysage, attention portée aux sentiments, subtilité du thème… tous concours à faire de ce roman un nouveau petit bijou.
AUTRES ŒUVRES
Entre Ombres sur le soleil et Unearthly Neighbors, Oliver donna en 1957 à la SF un autre très beau roman : The Winds of Time (Les Vents du temps — paru chez Opta «Galaxie-Bis» puis chez J’ai Lu). Wes Chase adore la pêche à la truite — sa femme râle bien un peu, mais dans l’ensemble elle lui laisse satisfaire à cette lubie inoffensive. C’est ainsi que par un bel après-midi des années 50, Wes grimpe dans la montagne pour aller taquiner du poisson. Surpris en fin de journée par un orage qu’il n’avait pas vu venir, Wes trouve refuge dans une étroite caverne. Épuisé, transi de froid, il finit par s’endormir sur la terre battue. Pour être brusquement réveillé par l’ouverture d’une porte au fond de la caverne. Un être de grande taille l’observe ! Paniqué, Wes se précipite dans la forêt et tente d’échapper à l’étranger. Mais c’est peine perdue : il est rapidement rattrapé, et paralysé par un rayon étrange. Ramené à la caverne, il est introduit dans le bunker de l’étranger. Un bunker qui comporte aussi plusieurs niches creusées à même la pierre, où dorment encore d’autres hommes « différents ». Commence alors pour Wes le long calvaire de la détention, l’étranger apprend lentement son langage, puis lui raconte son histoire…
Le reste des Vents du temps est essentiellement occupé par le récit tragique que fait l’extraterrestre d’une expédition menée par son peuple pour, enfin, trouver une race humaine qui ne se soit pas auto-anihilée dans une guerre. Puis la panne du vaisseau spatiale, l’écrasement sur une Terre encore préhistorique. Et la décision : hiberner, en espérant se réveiller à temps avant la prochaine guerre totale, à temps pour profiter d’une technologie qui permettrait aux extraterrestres de retourner vers leur monde… Une décision désespérée, et qui ne peut résoudre le problème du passage du temps : naufragé, l’équipage l’est doublement — loin de son monde, et loin de son époque.
Les Vents du temps n’est pas pour rien le roman le plus connu d’Oliver : c’est peut-être son plus poignant, une approche profondément humaine du « premier contact ». Chargé d’émotion, il sait nous faire partager la douleur tant de Wes Chase que des naufragés. Pour jouer encore une fois au jeu des comparaisons, Hemingway semble rencontrer ici… Andrew Weiner, encore (assurément le plus « oliverien » des auteurs récents).
Dernier roman de science-fiction d’Oliver, Giants in the Dust (1976) est le récit d’un retour aux valeurs primitives de l’humanité — une thématique proche de celle de Unearthly Neighbors. Dans une œuvre qui est tout autant un roman de pure aventure qu’une réflexion sur l’évolution de l’homme, Varnum est un homme issu d’une puissante mais languissante civilisation technologique, qui décide d’infléchir le destin d’une planète encore primitive (où il se fait déposer), en appliquant ses théories anthropologiques quant à la nature humaine.
Chez un tout autre auteur, une telle thématique risquerait fort de dégénérer en démonstrations manichéennes et réactionnaires. Chad Oliver se garde bien de tomber dans ces pièges. Si ses théories ne m’ont pas réellement convaincu, elles sont exposées de manière honnête et ouverte.
Les nouvelles de Chad Oliver furent réunies en recueils, d’abord en 1955 dans Another Kind, puis en 1971 dans The Edge of Forever.
Fort occupé par son métier principal, Chad Oliver écrivit relativement peu, mais il trouva tout de même le temps d’écrire en sus de sa science-fiction deux romans entre western et histoire, The Wolf is my Brother (1967, sur les Amérindiens) et Broken Eagle (1989). Je n’ai malheureusement pas pu les lire (les ouvrages hors genres sont particlulièrement difficiles à trouver d’occasion). Ils furent en tout cas suffisamment remarqués pour recevoir chacun un prix littéraire — alors qu’aucune des incursions d’Oliver en SF ne fut ainsi récompensée. Un dernier roman historique, teinté de fantastique, Cannibal Owl, fut annoncé en 1994, mais sa sortie fut abandonnée par l’éditeur faute d’un nombre suffisant de commandes de libraires.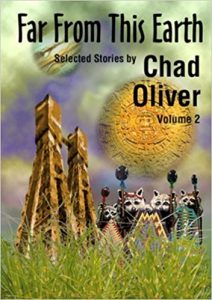
Jamais spectaculaire, toute en demi-teintes, constituée de romans brefs et un peu oubliés, l’œuvre de Chad Oliver se situe pourtant en plein cœur de la science-fiction : le genre n’en finit pas d’explorer les thématiques qu’il avait ouverte avec la force tranquille de l’évidence.
[1]Francis Valéry, in « L’hypothèse anthropomorphique dans l’œuvre romanesque de Chad Oliver» (KBN n°4, mai 1992).