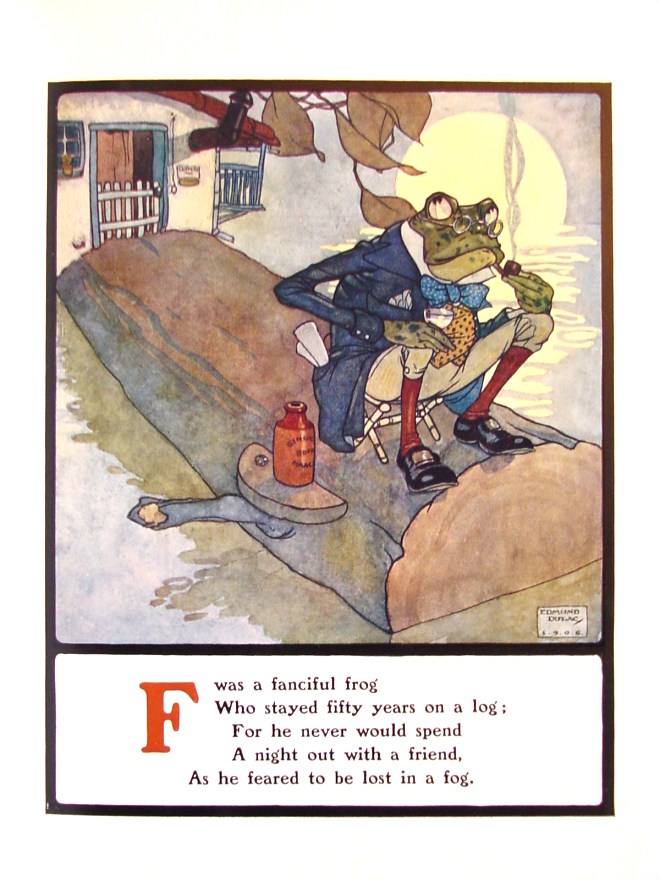Il y a quelques années, j’avais participé à un colloque universitaire. J’en avais déjà fait un d’antan, à Nice et dans le domaine de la science-fiction, mais cette fois il s’agissait d’un sujet qui m’est cher de manière plus « intime », à savoir la psychogéographie. La Lyonnaise Nathalie Caritoux avait organisé tout cela, et je viens d’en recevoir le recueil — un très beau petit livre, et ça c’est plutôt une (bonne) surprise car d’ordinaire les livres universitaires sont laids et pauvrement imprimés — ceux de la collection SF des PUB par exemple sont des sortes de vilains cahiers collés trop souples, le genre de trucs que l’on a la pauvreté intellectuelle de faire passer en France pour des livres alors qu’ils ne sont que l’illustration de l’incompétence des imprimeurs de notre belle nation… enfin bref ![]() Eh bien, celui-ci en tout cas est un vrai livre, couverture en carte vergée, rabats, papier intérieur ivoire, la classe quoi. Ne m’y cherchez pas, cependant : je n’ai pas écrit de papier pour ce colloque ; bien au contraire. D’une façon paradoxale qui m’amuse a posteriori, c’est le fait même que j’avais pris des notes qui m’avait mis brièvement en difficulté : devant mes notes, je m’étais retrouvé muet, incapable de restituer ce chemin-là de pensée puisqu’il était déjà écrit. Pour moi, un texte écrit, rédigé, est un texte que je n’ai plus « en tête ». J’avais donc abandonné mes fichues notes et improvisé, comme je le fais chaque fois que j’ai une intervention à faire. Pour moi, l’oral c’est de l’impro et j’y suis à l’aise (tiens, l’éditeur de l’Arbre vengeur vient de me demander de faire l’an prochain une intervention devant ses étudiants de l’IUT Métiers du livre, voilà qui va m’amuser).
Eh bien, celui-ci en tout cas est un vrai livre, couverture en carte vergée, rabats, papier intérieur ivoire, la classe quoi. Ne m’y cherchez pas, cependant : je n’ai pas écrit de papier pour ce colloque ; bien au contraire. D’une façon paradoxale qui m’amuse a posteriori, c’est le fait même que j’avais pris des notes qui m’avait mis brièvement en difficulté : devant mes notes, je m’étais retrouvé muet, incapable de restituer ce chemin-là de pensée puisqu’il était déjà écrit. Pour moi, un texte écrit, rédigé, est un texte que je n’ai plus « en tête ». J’avais donc abandonné mes fichues notes et improvisé, comme je le fais chaque fois que j’ai une intervention à faire. Pour moi, l’oral c’est de l’impro et j’y suis à l’aise (tiens, l’éditeur de l’Arbre vengeur vient de me demander de faire l’an prochain une intervention devant ses étudiants de l’IUT Métiers du livre, voilà qui va m’amuser).
Ce fut une expérience fort agréable, ce colloque — discuter avec l’irrépressible Thierry Paquot (pape français de ces questions), rencontrer mon camarade toulousain Matthieu Duperrex ou dîner en compagnie de l’Anglais Christopher Hauke — dont l’intervention très peu universitaire mais très littéraire et poétique, donc bien dans l’esprit psychogéographique, avait déplu à une académie toujours aussi rigide. Je retrouve donc avec grand plaisir le papier de ce dernier, belle dérive dans Londres. Enfin voilà, ce livre constitue pour moi un joli souvenir de l’une de mes rares expériences positives de la fin de mon séjour lyonnais.